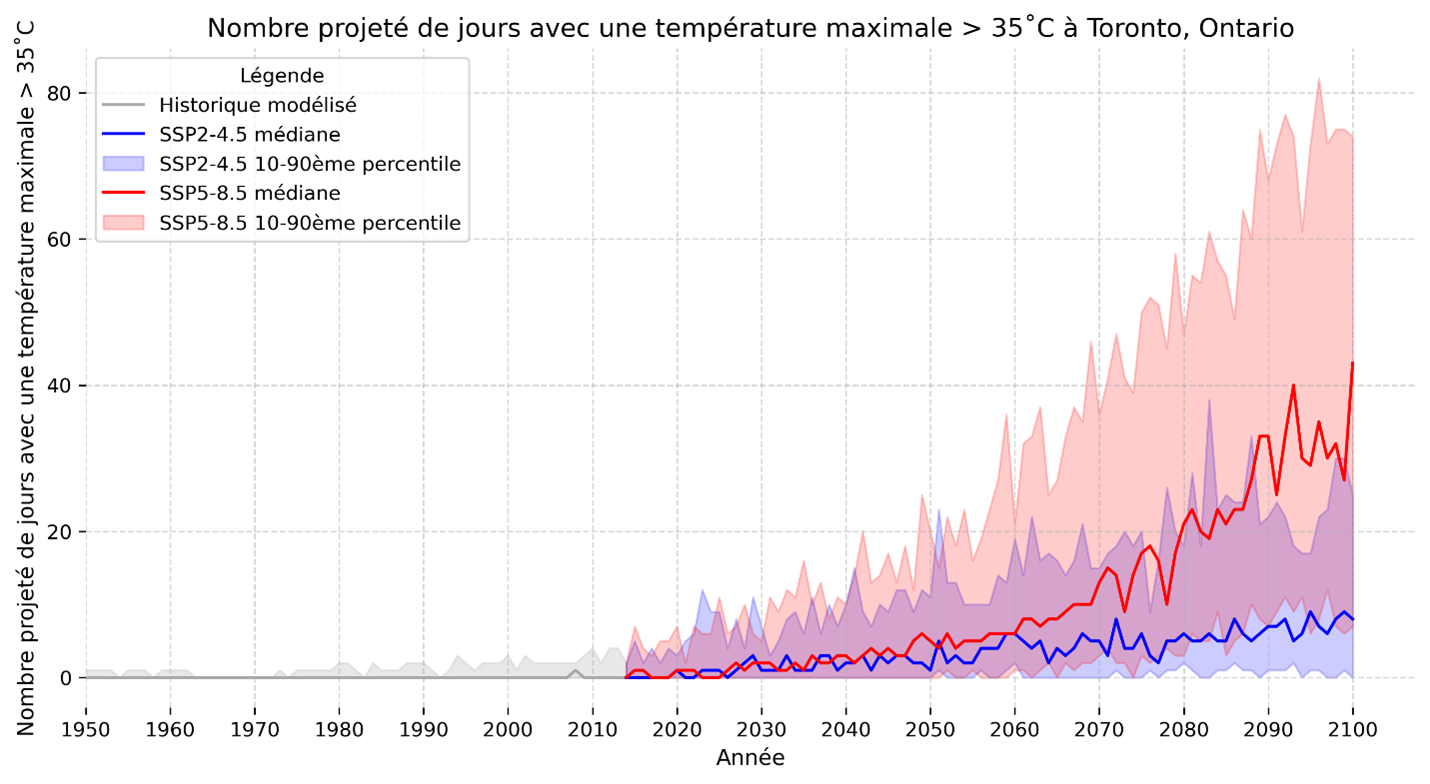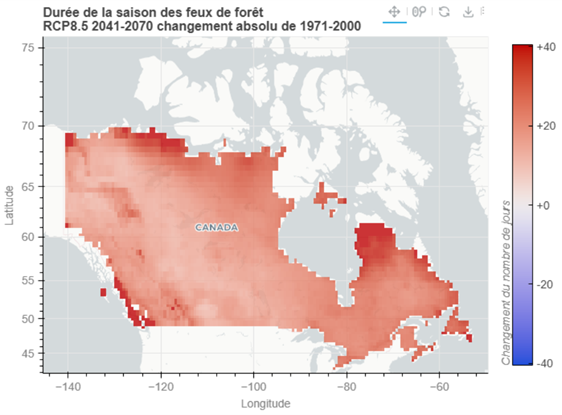Pluies extrêmes, tempêtes côtières et dommages aux sentiers côtiers
À mesure que le climat se réchauffe, le risque de tempêtes plus importantes et plus puissantes augmente également. Dans le Canada atlantique, on craint que le réchauffement de la température de surface de la mer n’entraîne des ouragans plus puissants. Ces phénomènes climatiques, combinés à l’élévation du niveau de la mer, peuvent présenter des risques supplémentaires pour les sentiers de loisirs en plein air.
Un exemple récent est l’ouragan Fiona, qui a frappé l’est du Canada en septembre 2022 sous la forme d’un puissant cyclone post-tropical, provoquant des précipitations et des ondes de tempête record. Certaines parties de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve ont enregistré entre 50 et 200 mm de pluie en 24 heures, provoquant des inondations sévères. Le long de la côte, des ondes de tempête de plus de 3 m de hauteur ont frappé le littoral. Certaines sections de la Cabot Trail au Cap-Breton ont été emportées ou ensevelies par des glissements de terrain, plusieurs parcs et terrains de camping ont dû fermer et les sentiers côtiers ont subi une érosion importante des plages et des sols. Les gouvernements ont dû investir des dizaines de millions de dollars pour reconstruire les routes, les ponts et les sections de sentiers endommagés. Par exemple, plus de 40 millions de dollars ont été alloués à la réparation des infrastructures du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton et des zones environnantes.[6] Un sentier côtier emblématique, le sentier du phare de Louisbourg, a nécessité environ 158 000 dollars de réparations et de rénovations d’urgence financées par la province. [7]
L’ouragan Fiona a mis en évidence la façon dont les phénomènes climatiques extrêmes combinés peuvent submerger les réseaux de sentiers : fortes précipitations associées à l’élévation du niveau de la mer et à des vents forts peuvent entraîner des inondations destructrices. On s’attend à ce que les changements climatiques rendent ces événements plus fréquents. Le réchauffement des températures de l’océan et de l’air entraîne déjà des ouragans plus pluvieux et plus venteux, et les tempêtes se déplacent plus au nord qu’auparavant.[8],[9] Les projections futures indiquent que ces tendances se poursuivront, ce qui signifie que le Canada atlantique doit se préparer à des tempêtes plus fréquentes et plus élevées (voir encadré 2).